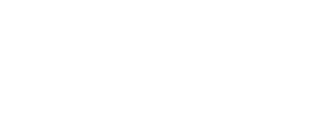La création au Maroc d’un système éducatif moderne est le produit de la volonté d’un homme, le Maréchal Lyautey, premier Résident Général de France au Maroc et de l’essor d’une ville, Casablanca, dont le développement démographique et économique nécessitait la formation d’une élite intellectuelle.
Rares sont en France, les écoles à porter le nom d’un militaire.
Rares sont les écoles françaises dans un pays étranger à porter le nom d’un personnage politique, à plus forte raison quand celui-ci a exercé un pouvoir de tutelle sur ledit pays.
Pourtant, curieusement à Casablanca, le lycée français porte le nom du Maréchal Lyautey, premier Résident Général français au Maroc. Curieusement ? Ce choix implique plus que la décision des associations d’anciens élèves marocains du lycée de conserver ce nom après l’Indépendance.
Le personnage de Hubert Gonzalve Louis Lyautey (1854-1934) dépasse, dans la mémoire collective, l’image traditionnelle d’un représentant d’une puissance occupante.
Il est utile dès lors de distinguer les fonctions qu’il incarne de l’homme et de sa personnalité.
En effet, le haut fonctionnaire français est chargé de mettre en place et de prolonger les applications concrètes d’un traité de protectorat signé en 1912, à Fès, entre le Maroc et la France. Le Protectorat, cadre institutionnel original à la notion juridique incertaine, avait déjà été expérimenté par la France au Cambodge, en Tunisie, à Madagascar et n’était aux yeux de beaucoup de français de ce début de XXe siècle qu’une solution transitoire, l’assimilation restant le but ultime. Ainsi, Madagascar, protectorat en 1885, était devenu colonie en 1896.
D’autre part, le personnage, dès son arrivée, a exprimé au sujet du Maroc un avis totalement différent : “Ici, nous avons réellement trouvé un état et un peuple”.
Il ne s’agissait dès lors, en aucune manière de coloniser le pays mais seulement d’y rétablir la paix civile (l’intervention française au Maroc en 1911 est motivée par les difficultés que rencontre le sultan à maintenir son autorité sur les tribus révoltées) et de le faire accéder à la “modernité”.
Lyautey affirme en outre son désir de voir respecter les coutumes et traditions du pays et fait sienne cette formule : “ce peuple n’est pas inférieur, il est différent”.
C’est dans cette dernière exigence que l’étude de la personnalité du Maréchal Lyautey prend toute sa dimension.
Quand il arrive au Maroc en 1912, Lyautey veut devenir le “Monsieur d’ici”, nom qu’il donnait à Gallieni lorsqu’il servait sous ses ordres au Tonkin, puis à Madagascar dans les années 1890.
Gallieni, admirable organisateur, méprisant les routines de la bureaucratie, animateur et créateur de vie, avait pacifié le Tonkin et Madagascar en économisant les vies humaines, en respectant les consciences et les intérêts légitimes de tous.
Au Tonkin par exemple, Gallieni et son état-major (dont Lyautey) se découvrent ingénieurs pour les routes, architectes pour les villes, agronomes pour les campagnes, enseignants enfin. “Faire de la vie” en somme.
Et effectivement, le Maroc devient un vaste chantier supervisé par Lyautey. On bâtit des villes, jette des ponts, trace des chemins de fer, creuse des ports, défriche des terres, exploite des mines ; Casablanca, exemple des rêves de grandeur de Lyautey, est le témoin de cet élan créateur.
Bien sûr, le “Saint n’était pas sans péché”. En voulant faire du Maroc un “état moderne”, Lyautey voyait aussi les intérêts de la France : œuvre civilisatrice pour la bonne conscience, ce pays représente aussi un énorme marché à investir et à contrôler pour les banquiers et les entrepreneurs venus de la métropole.
Cependant, il était contre la colonisation de peuplement (pour lui, la terre devait rester marocaine) et ne souhaitait voir s’installer au Maroc que de grandes organisations, ce qui lui valut des ennemis dès son arrivée. Dès 1912, est créé l’ Office Chérifien des Phosphates dont les revenus servent au développement des infrastructures du pays.
Il n’est pas question ici de refaire le procès de la colonisation. Justement parce que, tous s’accordent à le dire, Lyautey est un colonisateur atypique.
C’est bien pour cela qu’il constate dès 1920, dans la circulaire restée célèbre qu’il adresse à ses proches collaborateurs, qu’entre la politique qu’il aurait voulu que la France applique au Maroc et la réalité, le fossé se creusait de plus en plus.
Ainsi, à la notion de contrôle français sur les institutions marocaines (notion explicite du traité de protectorat) s’opposait de plus en plus la notion d’administration directe. Le Sultan, dont Lyautey, monarchiste, se voulait le premier serviteur, s’il disposait du pouvoir législatif et promulguait les lois, n’en avait pas l’initiative.
De plus, très peu d’emplois administratifs étaient aux mains des Marocains, les étudiants marocains pouvant devenir cadres dans l’administration (notion de gestion indirecte) voyant leurs chances limitées sous la pression des colons.
Le rôle des pachas à la tête des grandes villes, par exemple, n’était que fiction.
L’immigration des petits colons européens, que Lyautey voulait de toutes ses forces limiter, n’y voyant que graine de discorde avec une population en pleine explosion démographique et qui avait besoin de toute sa terre pour nourrir ses enfants, était de plus en plus importante et posait déjà des problèmes de cohabitation dans les campagnes.
L’entreprise de pacification n’était pas terminée, de nombreuses tribus refusant encore la présence française.
Ainsi, même la politique d’enseignement ne faisait pas l’unanimité, la majorité de la jeunesse marocaine continuant de ne pas y avoir accès.
Constat d’échec ? C’est probablement sur cette impression que Lyautey choisit de rendre sa charge de Résident Général en septembre 1925, ne supportant pas les obstacles que met la bureaucratie parisienne à son entreprise marocaine et qui lui reproche de ne pas voir affluer assez vite vers la métropole les fruits de ses investissements au Maroc.
Il quitte le pays dans l’indifférence des autorités françaises. De retour en France, il deviendra un ambassadeur informel du Maroc lors de l’exposition coloniale de 1931. Il meurt en 1934, la France reconnaissant bien tardivement son œuvre créatrice. Lyautey aimait passionnément le Maroc et il pensait que la création d’un pays moderne n’était possible qu’avec l’adhésion des cœurs. Il laissera derrière lui le goût doux-amer de ce qu’aurait pu être une grande œuvre de fraternisation, un pont jeté sur la Méditerranée, reliant ses deux rives.
Christophe Primault Professeur au Lycée Lyautey
 Lycée Lyautey de Casablanca établissement en gestion directe de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger
Lycée Lyautey de Casablanca établissement en gestion directe de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger